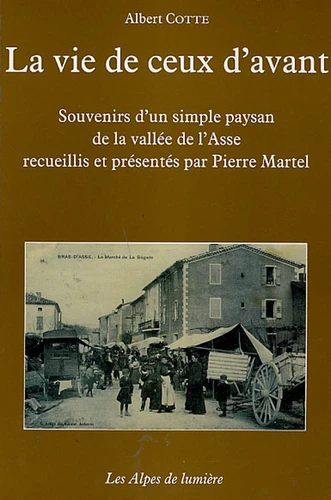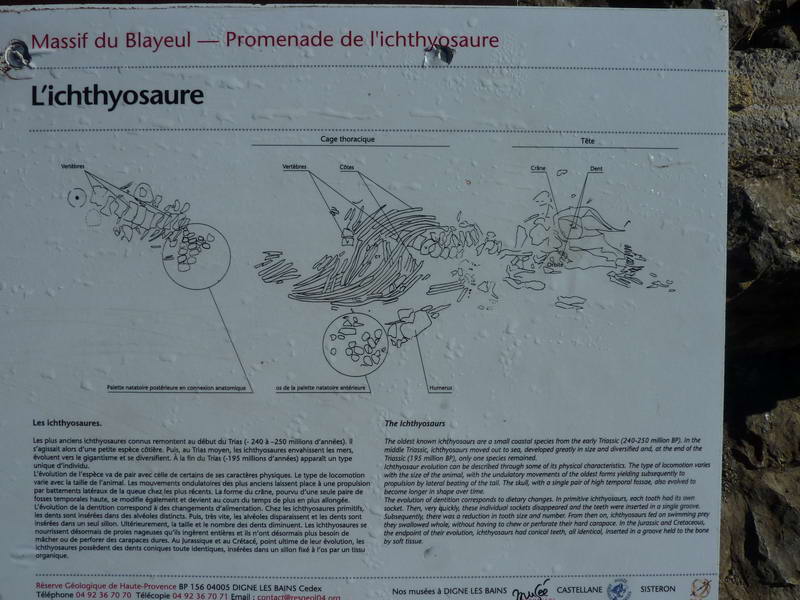Bonjour,
Parfois certains lieux sont magiques, le fait de passer dans un village abandonné c'est plein de mystères et en cherchant sur le net je suis tombé sur
ce livre

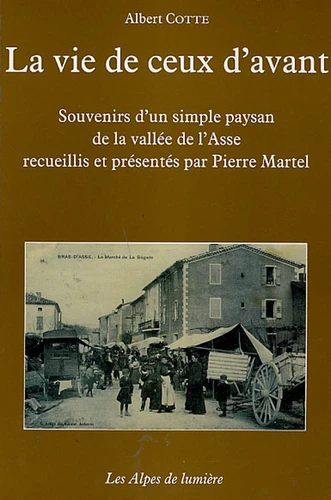
La vie de ceux d'avant. Souvenirs d’un simple paysan de la vallée de l’Asse
Auteur(s) : Albert Cotte. Présentation de Pierre Martel
Le Poil : un village perdu, « cramponné à une lame calcaire presque verticale » : c’est là qu’est né Albert Cotte simple paysan de la vallée de l’Asse qui nous livre ses souvenirs et son combat de toute une vie pour s’en sortir coûte que coûte dans ce rude pays et en ces rudes temps. Un bel exemple à méditer.
Du village perdu du Poil, dans les Préalpes de Digne, où il est né en 1907, au domaine de Sargan dans la moyenne vallée de l’Asse, Albert Cotte a vécu l’abandon de terres trop pauvres, et la reconversion des paysans des zones de montagne sèche.
----------------------------------------
Ce livre est aujourd'hui indisponible, j'ai eu la chance de me le faire prêter : Randonner dans le coin, puis lire ce livre => ça remet un peu les choses en place ...
Je me suis permis de scanner quelques extraits pour le faire partager :
1907-1922 LE POIL, MON VILLAGE
Je suis né au Poil, au début de ce siècle. En 1907.
Le Poil est un village perché à 1220 mètres d'altitude, dans une position très pittoresque, au pied d'un immense rocher long et étroit, comme un “pieu”, - ce qui est, dit-on, à l'origine de son nom: lou Péu, en provençal.
Le Poil est aujourd’hui un village mort, presque entièrement ruiné. Pourtant en 1900 plus de 200 habitants occupaient le village, les hameaux de Preynes et des Moulières et une dizaine de campagnes : la Combe, Chabannes, le Pré-du-Pin, l’Enfarnet, Saule-Mort, les Senières, Saint-Jean, Soleille-Boeuf, le Gros-Jas... Et encore son déclin était déjà amorcé, puisque la commune, qui avait 335 habitants en 1856, en avait déjà perdu 135 !
Le chef-lieu de canton était Senez, mais c’était un pauvre village. Mézel était à 20 km. Le village le plus proche était en réalité Barrême. Comme il n’y avait alors aucune route carrossable, c’est surtout de Barrême que l’on montait au Poil, par monts et par vaux, à pied ou à dos de mulet. On traversait la rivière de l'Asse sur une passerelle branlante, près d°une “halte” sur la voie ferrée du “train des Pignes”, le chemin de fer à voie étroite de Digne à Nice. Cette halte se limitait à un écriteau de bois sur lequel étaient écrits les noms de “Le Poil-Majastre” ! On gravissait les vallons de Saint-Maime, des Moulières, du Pré-du-Pin, pour découvrir enfin le village du Poil depuis le col du Thouron, où passait la carraíre des troupeaux. Ces pauvres chemins, mal empierrés, sur des sols argileux la plupart du temps, étaient entretenus par des “prestations”. Chaque contribuable devait donner chaque année trois journées de prestations. Ceux qui avaient des chevaux ou des mulets les amenaient avec un tombereau si les routes étaient carrossables. Les autres apportaient des pelles ou des pioches. Tous travaillaient sous la direction du chef cantonnier.
A côté du Poil, du côté du soleil, se trouvait un autre petit village appelé Majastre, moins peuplé, mais dont le chemin avait au moins l`avantage d’être carrossable. Il y reste encore, de nos jours, deux familles.
Après Majastre, il y avait encore Levens, où vivaient une dizaine de familles. Il n’y reste plus que des tas de pierres I Les Eaux-et-forêts ont tout recouvert de pins et il y a plus de vingt ans déjà que l’on ramasse des champignons sur cette terre foulée par tous ces gens il n'y a pas si longtemps encore.
Tout autour du Poil. il y a une couronne de villages ou de hameaux eux aussi complètement abandonnés: Creisset, La Melle, Bédéjun... La commune de Levens a été rattachée à celle de Majastre; celle du Poil a aussi perdu son identité: elle a été rattachée en 1981 à celle de Senez, dont elle n’est même pas limitrophe !
Pourtant quelle vie intense il y a eue autrefois dans ces montagnes ! A Levens, j’ai bien connu une famille Bondil qui a élevé cinq enfants : ils sont tous descendus vers Riez et Moustiers. A l’Enfernet, la famille Garron avait réussi à élever 15 ou 18 enfants, on ne sait plus bien le nombre. Aux Praux, dont la route est aujourd'hui coupée par l`Office national des forêts, une autre famille Bondil avait élevé 11 enfants, dont le dernier (Victorin) est encore en vie, à Beynes.
A Aubounelle (ou Valbonnelle), il y avait une autre famille de 11 enfants, les Gilly. Ils sont actuellement tous morts. La ferme aussi. Les terres aussi. Il n’y a plus personne dans la haute vallée de l`Estoublaïche (ou Estoublaïsse): ni hommes, ni bêtes d’élevage. Tout est revenu à la forêt.
Le goudron sur les routes, l’électricité, le téléphone, tout cela n`est arrivé que récemment: dans les années 60 à Majastre ou à Preynes. Au Poil, jamais. La dernière famille de Peloux (habitants du Poil), les Germain, est partie après la guerre pour des Zones plus hospitalières : le quartier de Palus, à Beynes, où ils avaient acheté une maison et des terres. Ici, ce n’était vraiment plus possible.
Aujourd'hui, quand on goudronne une route, on met une bonne couche de “tout-venant", on nivelle, on arrose, on roule et on goudronne: tout cela avec de gros engins qui font très vite le travail. Je me souviens qu'après 1914 on charriait une grosse rangée de pierres au bord de la route, que des hommes cassaient avec des massettes à manche rond et flexible, puis, avec des fourches à cailloux, ils les répartissaient sur la route à chausser, les arrosaient et les roulaient avec un rouleau à chevaux, “le cylindre”, plus tard avec un rouleau compresseur muni d`un moteur. C’était un autre monde.
Dans ces montagnes, dès que l'hiver arrivait, une épaisse couche de neige ensevelissait tout durant trois mois ou plus ; la pelle ne quittait plus le devant de la maison. On était coupés de tout. Au Poil, début décembre, il fallait avoir fait les provisions pour tout hiver et les 8 familles du village s’apprêtaient à vivre coupées du monde, au rythme ralenti de la “morte” saison.
La vie était si difficile que lentement le village mourait. De nos jours, il est tout en ruines, sauf l’école qui a été restaurée et transformée en “gîte d’étape” pour ceux de nos contemporains qui s`adonnent à la randonnée dans ces sites perdus mais superbes.
Le dernier Peloux que l`on a enterré au cimetière, en 1979, s’appelait Isaïe Piérisnard. C’était un célibataire, à peu près de mon âge. Après avoir perdu ses parents, un frère et une sœur, il était resté seul. Sa maison était au quartier de Soleille-Boeuf, sur la route de Majastre. En plus, il était malade. Pour calmer ses douleurs. Il prenait avant les repas un verre à liqueur d`une mixture faite avec dufiel de veau ou de bœuf qu’il faisait prendre à l’abattoir de Digne. Il avait fini par vendre sa maison en viager, tout en se réservant un petit appartement où il a vécu ses derniers temps.
Dans le même quartier, cent mètres plus loin, il y avait une maison où habitait un autre malheureux nomme Brosi. On ne peut pas imaginer où peut conduire la solitude et la misère. Celui-là avait percé un trou dans le mur donnant sur la route. Par cette meurtrière, il tirait avec son fusil sur le premier qui passait sur la route. Trois voisins ont réussi à le prendre et l`ont attaché mains et pieds. On l’a porté ainsi à l’asile des fous de Montdevergues.
L’église du village, elle aussi, s`est écroulée: quelques années encore et il n’en restera plus trace. On ne saura plus que le petit carré sous la roche qui est de l’autre côté du chemin était le cimetière.
Entre l'église et le cimetière, il y a un vieux chemin; il profite d’une profonde échancrure dans le rocher qui domine le village et l’abrite. Cette “porte du vent” fait communiquer le Poil avec Preynes et le monde de l’ouest. Ce vieux chemin calade est emprunté parfois par des randonneurs. Vous qui me lisez, vous y passerez peut-être un jour. Comme bien d’autres, vous vous poserez beaucoup de questions sur la vie et la mort des villages : il n’est donc peut-être pas inutile de vous raconter comment les gens d’ici ont vécu, ont tenu, autant qu’ils l`ont pu” (an viscu, an tengu, tant coumo an pouscu..., célèbre “Chant des Aïeux” des Provençaux). Les Peloux auraient tant de choses à dire.
Et c’est en approchant de la fin du rouleau que je repense à la vie de ces ancêtres. Peut-être étaient-ils aussi heureux que nous en fin de compte. Certes, ils ne connaissaient pas le confort, mais ils avaient peut-être plus de “santé” que nous. J’entendais souvent dire: “Escapo aqueou qu’a boueno maire” (s’en tire et va loin celui qu’à une bonne mère) !
UN GRAIN DE SABLE AU BORD DE L’ASSE
Arrivé à l’âge des réflexions, c`est de ce pays et de ce temps que j’ai eu envie de parler.
Pourquoi? Je ne sais pas bien. Pour établir un bilan. J’ai vécu, quand j`étais jeune, une époque qui a été bien dure, épouvantable même par certains côtés, quand on compare avec ce qu'on vit maintenant.
Mais une vie très belle quand même I Ces souvenirs ne sont pas des regrets. Je les écris, non pas pour me faire remarquer: je n’ai été qu'un homme des plus ordinaires, un simple paysan de la vallée de l’Asse, un grain de sable au milieu de tant d’autres au bord de la rivière. Je crois que j'ai écrit cela pour mes petites filles, pour qu’elles puissent savoir la vie qu’on a menée, le travail qu`on a dû faire, ce qu'il a fallu savoir et savoir-faire.
Ces souvenirs, je les ai écrits au fur et à mesure qu'ils se présentaient. J’ai consacré trois hivers à ce travail; puis encore, après, bien du temps à les regrouper au mieux, à les compléter, à les rendre présentables. Un jour quelqu’un m’avait dit, après en avoir lu quelques-uns : “Ces récits, il faudrait les faire éditer: ce serait juste qu`on sache mieux la vie que nous avons menée, nous, les gens des pays perdus !” J'espère que tous ceux qui ont trimé, qui ont connu la vie dure, s`y reconnaîtront et c’est pour cela que je suis heureux que ce livre puisse paraître. La vie de ceux d'avant ne doit pas s’oublíer.
C’est peut-être aussi pour autre chose: pour mieux comprendre moi-même ce qui s’est passé autour de moi, pendant plus de 80 ans. En effet, j`ai noté au passage un certain nombre d'observations, qui sont à la fois des regrets et des questions: la mort des villages, c’est sûr, mais aussi la disparition, par exemple, de certains oiseaux, de certains animaux sauvages, pour des raisons que je ne comprends pas ; le gaspillage des ressources de la nature, la pollution, l’énormité des décisions imbéciles dont on ne sait plus qui les prend. Ce livre pose pas mal de questions de ce genre : les lecteurs chercheront, et peut-être apporteront des réponses.
Enfin, je tiens à dire que je ne regrette pas ce passé, cette vie de labeur et de peine : c`était un bon temps. C`était dur, mais on vivait eton vivait plus calmement que de nos jours. Et ça, si c'était déjà le bonheur ?
LE TEMPS DES MATEFAIMS ET DE LA CASSEILLE
Si mes parents travaillaient dur l’été, en hiver c’était un peu le repos. Le matin, pendant que mon père allait faire une ronde aux étables et donner à manger aux mulets, ma mère allumait le poêle. Pendant que l`eau chauffait dans une casserole, elle plaçait un moulin à café entre ses genoux. Au café moulu, elle ajoutait quelques grains d’orge grillés, versait le tout dans la casserole et laissait bouillir. Lorsqu’elle retirait la casserole du feu, le marc se déposait au fond. (Tai vu un jour la patronne d'un café-restaurant de la vallée mettre du café moulu dans un sac de toile et faire bouillir le tout dans une grosse marmite de fonte. Ce même sac servait tant qu`il n'était pas troué.)
A part les tout-petits, mes parents et nous, mangions la soupe trois fois par jour, matin, midi et soir. Tous les jours, ma mère en faisait une grosse marmite et chaque fois elle variait: pommes de terre, choux, lentilles, haricots, raves, courges, épeautre, etc. Ce qui la rendait bonne, c'était le morceau de lard qu’elle y ajoutait. Elle le séparait de la couenne et le coupait bien fin. On mangeait alors la soupe dans des assiettes creuses d’un centimètre d’épaisseur qui n’existent plus aujourd'hui. Le bout de couenne qu'il y avait, on ne le donnait pas aux chiens, on se battait pour l’avoir.
On possédait tout en double pour la cuisine : un mupín pour cailler le lait et deux poêlons en terre pour le faire chauffer, car le lait ne se fait jamais bouillir dans le fer. Les poêlons périssaient tous par la queue. Pour les couverts qui avaient un peu rouille durant l’hiver, ma mère avait un bon truc : elle les frottait avec de la cendre. Sur la table, il y avait une cruche en terre pour l’eau et des quarts de l`armée en guise de verres. Les assiettes étaient toutes creuses.
Le menu quant à lui était toujours le même : trois fois par jour mon père et l’oncle remplissaient l'assiette de pain et versaient par-dessus la soupe, à ras-bord. Ensuite, du fromage sec ou de la casseílle sur du pain ou avec un oignon, ou encore, un matefaím, ou le bout de lard qui avait assaisonné la soupe. Il était jaune et rance, et je n'ai jamais pu le manger.
Les malefaims, chez nous, étaient de grosses crêpes nourrissantes : on mettait dans une poêle des lardons et du petit-salé et, pendant qu’ils grillaient, on mélangeait dans un plat un peu de farine, deux œufs, de I ”eau et on battait le tout; on vidait sur les lardons et on couvrait jusqu’à cuisson complète.
Si on avait encore faim après ça, il y avait toujours un fromage de chèvre, du miel ou des noix. Je n’ai jamais vu d’autre beurre ou d’autre fromage que les nôtres.
Quand on n`avait plus de petit-salé pour les crêpes et les omelettes, on le remplaçait par de la graisse de cochon.
A Chabannes, on mangeait aussi la casseille un fromage fondu très fort. Il y en avait toujours, dans une marmite spéciale. Quand les chevreaux étaient sevrés et qu’on pouvait faire des fromages, on y ajoutait une douzaine de demi-secs. Quelques jours après, c`était plein de vers, de ceux qui sautent : les sautaïres. On les entendait taper au couvercle de la marmite! Un mois après, la vermine avait disparu. On pouvait alors faire des tartines que l'on grillait un peu sur la braise de la cheminée. On se régalait. Si on avait pu accompagner ça d’un beau canon de vin, on aurait sans doute mieux apprécié encore, mais on ne buvait que de l’eau. Tous ceux qui avaient des chèvres faisaient de la casseille
Tous les deux jours, on faisait cuire une marmite de soupe pour nous et une autre pour le cochon.
Chaque matin, on remplissait le four de briques pleines et le soir chacun en glissait une au fond de son lit pour le chauffer. En plus, on le bassinait avec le chauffe-lit rempli de braises. Ceux qui couchaient dans la cuisine ou dans l’alcôve n'avaient pas froid, car le poêle brûlait toue la journée. Par contre, la chambre n’était pas chauffée. Pourtant, couchés dans une bonne paillasse remplie de feuilles de hêtres, on dormait bien. Il arrivait que la marmite de soupe, trop pleine, verse. Au lieu d'éteindre le feu, le gras coulait autour de la marmite. Cela faisait un excellent cirage pour nos souliers...
Si mes parents avaient vu le gaspillage d'aujourd’hui, ils se seraient arraché les cheveux. Ce sens de l'économie s’appliquait à tous les domaines de la vie: on récupérait tout, on ne jetait rien. On n’avait même pas de poubelle ! On gardait tout: un bouton trouvé sur le chemin allait dans la boîte à boutons; le moindre bout de fer était mis de côté; un jour ou l'autre, il trouverait une destination nouvelle. Même pour les guenilles les plus lamentables (les estrasses, les pates), il y avait justement le patíaire (le chiffonnier). Il s’annonçait dans les rues des villages par une sorte de chant monotone dont la version était la suivante : Pèu de Zèbre, pèu de lapin, lou marchand es un couquín ! Effectivement, il vivait surtout du commerce des peaux de lièvres et de lapins. On les gardait donc précieusement: il n’y avait pas de petits profits l
Un jour, j’ai vu un chien, en ville, sortir d'une poubelle plusieurs pieds de jambon. Au Poil, un jarret de jambon assaisonnait la soupe pendant plusieurs jours : c’était l'assabouraire, le “donneur de saveur”. Certains disaient : coumàíre, presta me toun assabouraíre (Commère, prête-moi ton assabouràire _ pour assaisonner ma soupe).
Mon père avait toujours du saindoux de cochon pour graisser les chaussures: cela les rendait souples et imperméables. Quand elles n’étaient plus réparables, le cordonnier prenait les mesures pour une autre paire. Elles étaient lourdes mais duraient des années.
Les vêtements, c’était ma mère qui les réparait avec le galon qu'elle achetait il Théodore, le colporteur (voir au chapitre 2). En général, un chapeau durait toute la vie. On disait pourtant: Fremo mourto, capèù noù (femme morte, chapeau neuf). Un veuf qui se mariait achetait donc un nouveau chapeau. Un veuf qui se remariait avec une jeune fille devait payer il boire a toute la jeunesse, ou alors il était suivi par les jeunes portant plusieurs sonnailles pendues à une barre de bois, que la nôvíe devait sauter à la sortie de la mairie.
Je me souviens d’un garçon et de son père. On avait remarqué qu'ils ne sortaient jamais ensemble: le même costume servait aux deux. Le père s’en est allé un jour du Poil, aussi. Il est mort très vieux. Il disait: “Dans ma vie, je me suis toujours levé avec la lampe”. Je le crois. mon père, et combien d’autres, tâtonnaient le matin pour attacher leurs souliers.
J’ai eu des camarades que les parents louaient dans de grosses fermes à la sortie de l”éeole, et le patron allait les appeler à la pointe du jour à la grange.